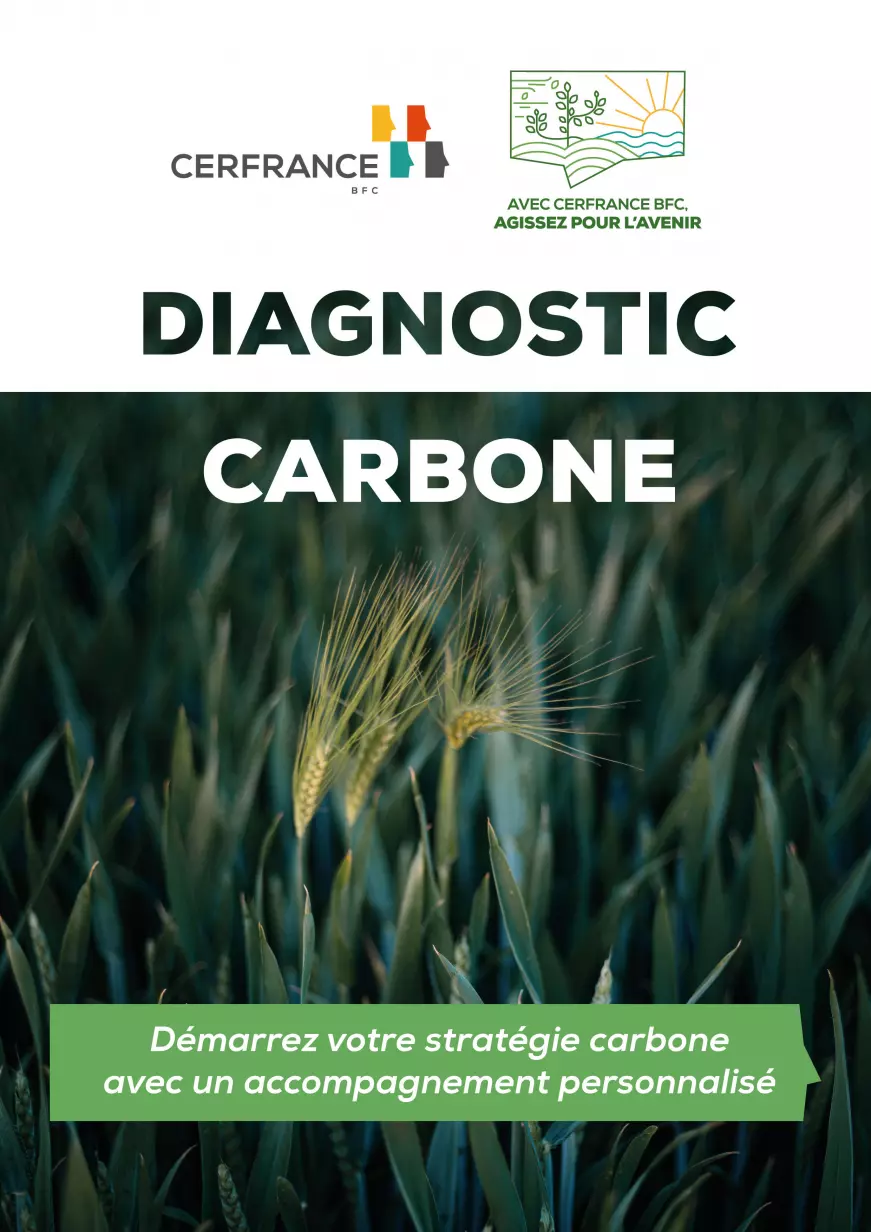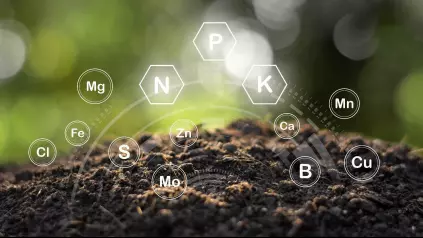Pâturage prolongé : plus de bienfaits, moins d’empreinte carbone !
Le pâturage présente de nombreux bénéfices à la fois pour la santé des animaux, pour les sols et la biodiversité et pour la production (de lait et de viande). Allonger sa durée constitue l’un des leviers possibles pour réduire l’empreinte carbone des exploitations agricoles : réduction du coût alimentaire, meilleure valorisation de l’herbe, optimisation de la gestion des déjections… Sortir les animaux à l’herbe précocement ou les rentrer plus tardivement, plusieurs options sont possibles.

Allonger la saison de pâturage en rentrant les animaux plus tardivement
L’herbe d’automne est une ressource intéressante à valoriser, en profitant du redémarrage des prairies pour diminuer la consommation des stocks. Il s’agit de faire pâturer le plus longtemps possible, tant que les conditions et la portance du sol le permettent. De cette manière, on améliore l’autonomie fourragère et on réduit les besoins en fourrages stockés.Cette pratique n’impacterait pas la pousse au printemps, puisque au contraire, un pâturage ras favorise l’accès à la lumière des graminées et légumineuses et leur reprise ultérieure.
« Les prairies produisent entre 1 et 2 T MS/ha pendant l'automne » (Idele)
Si les conditions de portance le permettent, on peut prolonger ce pâturage automnal par du pâturage hivernal, sur des prairies (à partir de 30 ares d’herbe par vache pour limiter le surpâturage) ou sur des dérobées. Il n’est pas nécessaire de sortir les animaux toute la journée, quelques heures suffisent pour limiter le piétinement.
Cette pratique est particulièrement adaptée sur les sols superficiels, caillouteux ou séchants, au contraire des sols argileux, inondables ou hydromorphes. L’état du sol pilote toujours le retrait des animaux du champ : arrêter le pâturage après un épisode de pluie ou de gel.
Les espèces plus adaptées au froid, qui pousseront le mieux en hiver, sont la fétuque des prés, la fléole, le RGH ou encore le dactyle. D’après l’Idele, « ces fourrages sont riches en énergie (près de 1 UFL/kg MS) et en protéines (20 % de MAT) : cela équivaut à un fourrage entre une 1ère et une 2nde coupe ». Ainsi, cette herbe serait suffisante pour couvrir les besoins d’animaux à faible objectif de croissance, comme les vaches taries, et permet donc de réduire les besoins en fourrages conservés.
Comme pour le pâturage d’automne, la productivité de la prairie l’année suivante ne serait pas impactée. Cependant, il est important de maintenir un temps de repos hivernal des prairies de 2 mois minimum en sortie d’hiver. De même, la période du 15 décembre au 15 janvier est à éviter pour ne pas menacer la pousse suivante, car c’est à ce stade que les talles de graminées et les stolons de trèfle blanc se mettent en place.
Allonger la saison de pâturage par une mise à l’herbe précoce
En mettant à l’herbe les animaux précocement, en sortie d’hiver, cela permet de leur faire bénéficier d’une herbe de qualité plus tôt et de réduire le temps en bâtiment, à condition d’avoir des parcelles suffisamment portantes pour les accueillir. Il est par exemple possible de faire pâturer des dérobées, des prairies séchantes ou des parcelles destinées à être retournées pour implanter des cultures de printemps. Le plus souvent, on réalise une mise à l’herbe progressive, sur 2 ou 3 semaines, avec une transition alimentaire (complémentation en fourrage selon le temps passé dehors).
Cela permet de :
- Économiser des stocks et des concentrés : « Avancer la mise à l’herbe d’une quinzaine de jours, c’est faire l’économie d’environ 3 t MS d’ensilage de maïs pour un troupeau de 65 VL pâturant 3 kg MS d’herbe/VL/jour » (Idele). Cela permet donc une réduction du coût alimentaire, des émissions de CO2eq et de la mécanisation associée.
- Nettoyer les parcelles mal pâturées à l’automne et valoriser cette herbe résiduelle : cela facilite le tallage des graminées et l’accès à la lumière des légumineuses.
- Créer un décalage de pousse de l’herbe entre les paddocks grâce au pâturage tournant.
- Limiter les risques sanitaires liés au maintien des animaux en bâtiment sur la durée (tels que les mammites).
Le pâturage en sortie d’hiver peut également s’envisager sur des céréales, avant leur récolte en graines ou en ensilage. Cette pratique concerne plus communément les ovins pour qui la contrainte de portance du sol est plus faible. Elle permet d’avancer la sortie des animaux (sur des surfaces portantes encore une fois), de réduire les apports de concentrés pour l’alimentation et de fertiliser les cultures.
Des essais ont été menés entre 2019 et 2022 pour en déterminer les conditions de réussite :
- projet PATURALE (financé par la Région Centre Val de Loire),
- POSCIF (IDELE, CIIRPO, Agrof’île, et financé par l’ADEME),
- et BREBIS_LINK (financé par le CASDAR).
Ce mode de pâturage ne doit pas être pratiqué à n’importe quel stade pour éviter les répercussions sur la récolte suivante. En effet, le stade de la céréale au moment du pâturage conditionne le rendement suivant : réalisé en cours de tallage, le rendement serait majoré en moyenne de 5 quintaux par hectare ; réalisé en fin de tallage ou à la montaison, le rendement serait dégradé respectivement de 3 et 7 quintaux par hectare[1]. De plus, les parcelles étudiées ont montré une réduction importante des maladies sur les céréales.
Enfin, une attention est à porter au piétinement du sol par les animaux. Pour les brebis, le piétinement n’a que peu d’impact. Pour les bovins, en revanche, il est préférable de choisir des animaux légers (les génisses par exemple), et le chargement doit être adapté pour éviter le piétinement des parcelles. Il est également possible de maîtriser le pâturage par fil avant-fil arrière.
Des conditions sont donc à respecter pour réaliser le pâturage des céréales dans les bonnes conditions et permettre une meilleure valorisation zootechnique des cultures.
[1] Source : Idele, CIIRPO, Agrof’île. Projet POSCIF. Décembre 2021
Vous souhaitez faire appel à nos experts pour évaluer l’empreinte carbone de votre exploitation ? N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse conseil@bfc.cerfrance.fr